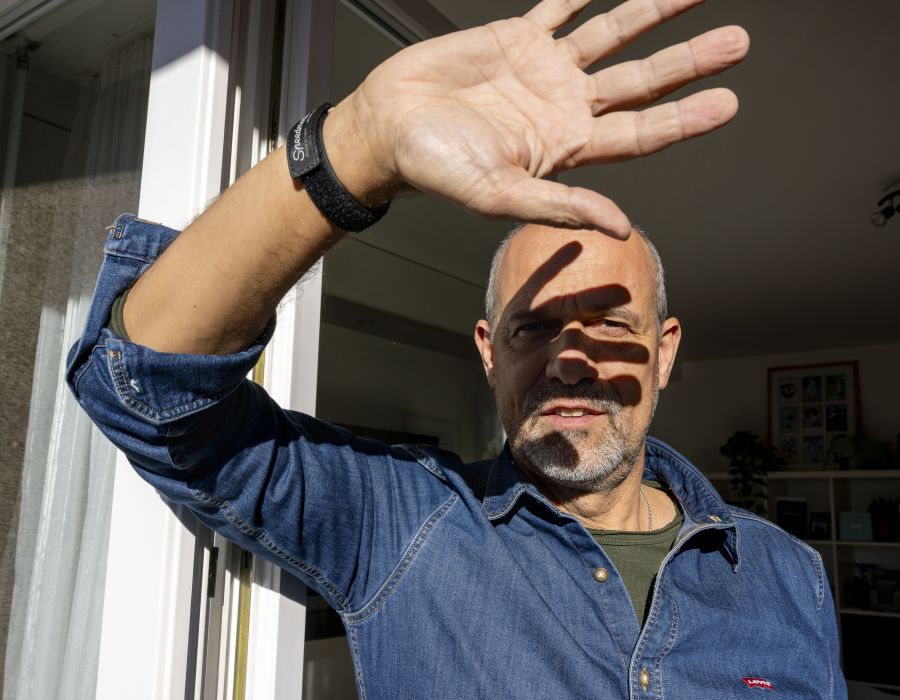«C’est comme envoyer des brebis à l’abattoir»

Lors du cortège du 1er Mai à Lausanne, des militants de Droit de rester ont appelé à la libération de Kevin emprisonné à Frambois. Il a été relâché le 12 mai.
Les Burundais de Suisse, avec le soutien du collectif Droit de rester, s’organisent pour dénoncer les expulsions forcées et pour que la Suisse leur accorde le statut de réfugiés.
Le 14 mai dernier, en début d’après-midi, de nombreuses personnes attendent en fil indienne pour déposer leur téléphone portable avant de s’installer dans la salle du centre socioculturel Pôle Sud à Lausanne. Les organisateurs, le tout jeune collectif des Burundais en Suisse, appuyé par Droit de rester, veut éviter toute fuite d’informations qui pourrait mettre en danger ceux qui vont s’exprimer. Une quarantaine de personnes, majoritairement originaires du Burundi, venues de plusieurs cantons, des militants pour le droit d’asile et des journalistes, vont écouter pendant deux heures les différentes interventions. La plupart sont à l’aide d’urgence, car déboutés de l’asile, certains à la suite d’une décision de non-entrée en matière Dublin (plusieurs ont d’ailleurs été renvoyés en Croatie malgré les violences subies dans ce pays) ou du fait de la non-reconnaissance des risques qu’ils encourent dans leur pays d’origine. Et pourtant…
Le Burundi en crise
La conférence débute par un retour sur l’instabilité politique qui n’a cessé de croître au Burundi. Il y a dix ans, en avril 2015, la population descend dans la rue pour manifester contre la candidature, pour un troisième mandat, contraire à la Constitution, du président Pierre Nkurunziza. Le gouvernement tire sur la foule, faisant plusieurs morts et blessés. Tout au long de l’année, la répression, les arrestations et les exécutions de civils opposés au régime font fuir plus de 400 000 personnes, majoritairement dans les pays voisins. Quelques années plus tard, plusieurs exilés sont rentrés dans leur patrie croyant au retour à la stabilité, notamment après l’investiture du président Ndayishimiye en 2020 (après la mort de Pierre Nkurunziza). Or, selon un rapport de la Focode, organisation de la société civile du Burundi basée en Belgique, nombre d’entre eux ont été arrêtés, ont subi des tortures ou ont été exécutés.
Une commission d’enquête indépendante des Nations Unies indique que «non seulement de graves violations des droits de l’homme ont continué d’être commises, mais à certains égards, la situation s’est détériorée». Ces derniers mois, une série de persécutions et d’intimidations envers des organisations de défense des droits humains ont fait fuir plusieurs de leurs représentants, même haut placés. L’avancée du M23 à l’est de la République démocratique du Congo (RDC) ajoute encore aux tensions politiques. Sans compter l’angoisse des élections prévues en juin. Face à cette situation explosive, l’ONU a d’ailleurs rapatrié les familles de son personnel. Le Département fédéral des affaires étrangères, dans sa rubrique «Conseils pour les voyages» écrit: «Les tensions politiques et sociales sont élevées et peuvent à tout moment mener à une détérioration de la situation sécuritaire dans tout le pays.» Il précise que «des personnes sont régulièrement tuées ou blessées lors d'actes violents d'origine politique ou criminelle, notamment lors des attaques à la grenade».
La peur au quotidien
«Or, quand on nous refuse l’asile, on nous dit que notre pays est en paix», explique l’un des requérants déboutés, témoignant aussi de la difficulté de vivre à l’aide d’urgence, de la peur d’être arrêté à tout moment et d’être expulsé. «Nous n’avons ni le droit de travailler, ni d’étudier. Et un retour volontaire est impossible pour nous.» «C’est comme envoyer des brebis à l’abattoir», assène son compatriote, vivant depuis 25 ans en Suisse et qui a décidé de soutenir ceux dont la qualité de réfugié est déniée, car «se taire, c’est être complice». A ses côtés, Kevin qui a été libéré quelques jours auparavant de la prison de Frambois, témoigne de sa résistance. «On a voulu me déporter. Deux policiers ont débarqué le 15 avril, vers 5h du matin. Ils m’ont menotté, m’ont emmené à Frambois. Heureusement, j’ai pu envoyer deux messages à des amis pour leur dire ce qu’il m’arrivait. Merci à eux, et merci beaucoup à Droit de rester.» Difficile de résumer son récit, tant le diable se cache dans les détails. Le 27 avril, de nouveau à l’aube, quatre policiers l’attachent et l’emmènent dans un avion avant l’arrivée des passagers. «Je leur ai dit que cela signifiait la mort pour moi. J’ai commencé à résister, à crier, et puis le capitaine de l’avion a dit quelque chose aux policiers et on m’a ramené à Frambois. Le 12 mai, on m’a libéré.»
Acharnement des autorités
Dans le public, Louise témoigne de la situation tout aussi violente et absurde vécue par une fratrie: «La famille, par peur, ne veut pas que je donne le nom de leur canton de résidence. Mais il est important de dénoncer cet acharnement des autorités. Trois jeunes majeurs, deux filles et un garçon, tous en formation, ont été emmenés tour à tour à l’aéroport. Une des filles s’est retrouvée en pyjama sur le tarmac… avant que le renvoi ne soit annulé à la suite de son refus. Le garçon a été mis en détention, s’est lui aussi opposé à son retour, et a été renvoyé dans son canton. Et la troisième était chez sa psychiatre lorsque la police a fait irruption. La jeune femme a eu un malaise et la médecin a dû appeler l’ambulance! Tous les trois sont traumatisés. L’une des sœurs n’arrive plus à sortir de chez elle, seule, et a même peur de la porte d’entrée!» La militante, active dans plusieurs cantons, souligne en aparté: «Je ne crois pas qu’il existe d’accord de réadmission avec le Burundi. Mais c’est un moyen de mettre la pression sur les demandeurs d’asile burundais pour qu’ils quittent le territoire… Dans les décisions négatives, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avance toujours le motif de l’invraisemblance. Et ce n’est pas facile de faire recours contre cela. Le taux de protection est très bas.»
«La Suisse devrait avoir honte!» réagit dans le public, Hugues, médecin à la retraite. Une consœur, membre de l’association Médecins action santé migrants, renchérit: «Après tous les traumatismes vécus au Burundi, puis lors de l’exil, s’en ajoutent encore d’autres ici.» Un Burundais débouté, assigné au canton du Valais, témoigne de sa peur d’être expulsé et de son incompréhension: «Les Conventions de Genève ont été signées par la Suisse pour protéger les personnes en danger…» Un autre partage son désarroi: «J’avais une entreprise dans mon pays. Je gagnais très bien ma vie. Comment peut-on me dire que je viens ici pour profiter?» Un compatriote raconte son parcours du combattant pour s’intégrer, dès son arrivée en Suisse. Après plus de deux ans de formation, des stages et du bénévolat, il raconte: «Au moment où j’ai décroché mon premier emploi d’aide-soignant dans un EMS, j’ai reçu une réponse négative à ma demande d’asile. Cela signifiait que je ne pouvais pas avoir d’autorisation de travail. Mon employeur m’a proposé de faire recours. Heureusement qu’une dame m’a aidé pour payer les 750 francs de la procédure! J’ai donc pu commencer à travailler…» Mais jusqu’à quand?